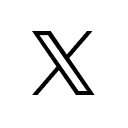Comment qualifier cette campagne sans quota ?
La filière est confrontée à une crise jamais vue depuis 50 ans. Cette année, on cumule des rendements betteraviers très moyens et surtout des prix très bas. Le rendement moyen français va difficilement atteindre les 83 t/ha à 16°S, contre une moyenne quinquennale de 89 t/ha. Les 483 000 ha ensemencés devraient produire 40 Mt de betteraves, soit une production en baisse de 14 %. L’an passé les excellents rendements de 96 t/ha à 16°S avaient permis aux betteraviers de dégager un revenu. Mais cette année, les planteurs vont perdre en moyenne 400 à 500 €/ha. C’est la première fois que l’on ne couvre pas nos coûts de production.
La libéralisation du marché a-t-elle changé les relations avec les industriels ?
Le cadre contractuel a été profondément bouleversé depuis la fin des quotas et les nouvelles pratiques sont loin d’être satisfaisantes. Les contrats n’indiquent pas un prix ou une règle de partage de la valeur. Or, si l’on se réfère à la réglementation européenne, un contrat doit comporter une quantité déterminée de betteraves et des prix qui devraient être connus avant les semis. Aujourd’hui, les planteurs ne savent rien pour la récolte 2019, sauf chez les deux sucriers indépendants Lesaffre et Ouvré, qui sont les fabricants les plus transparents sur cette question. Chez Saint Louis Sucre, il y a certes une grille de prix, mais les critères pour définir le supplément de prix ne sont pas très clairs. Je déplore également que Cristal Union ait abandonné le prix minimum de la betterave pour 2018. Enfin, Tereos a annoncé tenir 25 €/t pour 2017 et 2018, mais il n’y a toujours pas d’indication pour 2019, au moment où les agriculteurs vont acheter leurs semences. Globalement, les agriculteurs connaissent beaucoup trop tard le prix de leurs betteraves.
Quel type de contrat souhaiteriez-vous ?
L’idéal serait un prix minimum qui permette aux planteurs de s’engager et un supplément de prix en fonction du marché. Il faudrait que l’on puisse construire ce prix ensemble – planteur et fabricant – à l’aide d’indices et en adossant le prix de la betterave sur les marchés à terme du sucre. L’interprofession aurait dû mettre en place des indicateurs de prix plus précis, mais ce dossier n’avance pas. Il faudrait plus de transparence sur le partage de la valeur et les planteurs devraient connaître la décomposition du prix de la betterave à partir des différents marchés : domestique, européen, mondial, l’éthanol et bien sûr la pulpe. Les contrats doivent évoluer pour que les planteurs puissent avoir des perspectives de revenus quand ils prennent la décision de semer. Cette visibilité profiterait également aux usines qui sécuriseraient leur approvisionnement. Nos collègues betteraviers européens, notamment les Allemands, les Anglais et les Belges, ont souvent une meilleure connaissance de leur futur prix de betterave. Les planteurs français sont en plein brouillard en matière de rémunération pour l’an prochain.
Faut-il aller plus loin en créant des organisations de producteurs (OP) pour livrer les sucriers privés ?
La création d’organisations de producteurs de collecte et de vente de betteraves est une piste de réflexion pour les planteurs de Saint Louis Sucre. Le secteur betterave sucre a été écarté de l’article premier de la loi EGalim sous prétexte qu’il y a déjà un acte délégué européen qui donnait la possibilité de convenir de clauses de répartition de la valeur. Mais les commissions de répartition de la valeur que nous avons créées ne fonctionnent que si l’industriel joue le jeu. Or, on voit bien que le dialogue chez Saint Louis Sucre ne fonctionne pas. Les planteurs membres de la CRV n’arrivent pas à se faire entendre. La création d’une OP reconnue par l’État pourrait être une solution de rechange. Car une OP vient voir le fabricant avec les volumes confiés par ses membres et négocie les contrats, contrairement aux CRV où il n’y a pas de possibilité de négocier. Cela pourrait évoluer pour la campagne 2020-2021.
La crise actuelle peut-elle engendrer des restructurations avec des fermetures de sucreries ?
Il y a effectivement un risque que certains producteurs européens poursuivent la réduction de leur production de sucre, entraînant la fermeture de sites industriels. Mais dans de nombreux pays peu compétitifs, les betteraviers sont soutenus par les aides couplées. En France, il faut à tout prix éviter la disparition de bassins betteraviers. C’est notre priorité.
Pourquoi la CGB ne souhaite pas mettre en place une aide au stockage privé, comme le réclament certains pays européens ?
Nous ne sommes pas convaincus par ces dispositifs. Les effets potentiels comme la remontée artificielle des cours sont incertains. Par ailleurs, son financement pose question. Nous ne voulons pas que les fonds alloués à l’aide au stockage privé soient pris sur les aides directes. Quant à l’éventuel fonds de restructuration qui est proposé par certains, deux questions se posent : quels pays veulent réellement fermer leurs usines et comment finance-t-on cela ? Par rapport à ces questions, le premier enjeu est d’être mieux armé pour gérer la volatilité des prix. Ne doit-on pas piloter notre production en fonction de l’opportunité que constituent les marchés ? Et là, ce sont les contrats qui sont le premier outil. Ensuite, il s’agit d’utiliser les outils de gestion des risques, tels que les marchés à terme et les outils de gestion de crise avec les instruments de stabilisation du revenu (ISR) et une réassurance publique.
Comment voyez-vous l’année 2019 ?
La prochaine campagne s’annonce difficile. Pour la première fois, nous allons être confrontés à la suppression des néonicotinoïdes dans l’enrobage des semences. Cela va représenter un handicap majeur pour notre compétitivité, pouvant entraîner des pertes allant jusqu’à 50 % de rendements en cas de fortes attaques de pucerons, selon l’ITB. Aujourd’hui, nous n’avons aucune solution de rechange efficace. On sait déjà que l’insecticide Karaté K, à base de pyréthrinoïdes et carbamates, ne fonctionne pas, car de nombreuses résistances de pucerons sont apparues dans la nature. Dans le même temps, nous sommes mobilisés pour étendre l’homologation de la flonicamide, déjà utilisée en pomme de terre, à la culture de la betterave, afin de disposer d’une alternative dès 2019. Mais le dossier d’homologation date de 2016. Il est incomplet, car il était prévu pour un seul passage au stade 6 feuilles. Cela apparaît insuffisant.
Allez-vous poursuivre vos demandes de dérogation à la décision européenne d’interdire les néonicotinoïdes ?
Oui, nous continuons à faire des demandes au titre de l’article 53 de la réglementation européenne. Il faut pour cela que le gouvernement nous soutienne. Nous ne pouvons pas accepter des distorsions de concurrence en Europe, avec des pays, comme la Belgique, la République Tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie, la Croatie et la Pologne, qui peuvent bénéficier de dérogations et pas nous ! Cela crée une Europe à deux vitesses !
Quels sont les challenges que devra relever la filière pour son avenir ?
La filière betteravière a deux gros challenges à affronter : la compétitivité et les nouveaux modes de production, qui sont intimement liés. Il faut vraiment arriver à enrayer le déclin de notre compétitivité. Utiliser « moins » de produits phytosanitaires, ça ne veut pas dire « sans ». Il faut nous laisser utiliser certains produits si nous voulons continuer à avoir une filière française compétitive et efficace face à nos voisins. Pour cela, nous comptons sur les travaux menés par la recherche, l’ITB, et aussi sur les efforts des semenciers pour nous fournir des variétés toujours plus résistantes. La CGB continuera à défendre les techniques d’édition de gènes. Je ne comprends pas que la Cour de justice de l’Union européenne puisse assimiler les nouvelles techniques de sélection variétale à des OGM. Il devient urgent de construire un cadre réglementaire adapté à ces techniques. C’est une question trop importante pour l’avenir de notre production. L’essor actuel du bioéthanol est également à conforter avec les pouvoirs publics, pour soutenir notre filière. Nous avons l’assurance du soutien du ministre de l’Environnement, François de Rugy, pour porter la prise en compte de l’éthanol de résidus (sucres non–extractibles) au-delà du plafond de 7 % imposé aux biocarburants de première génération. Il va falloir aussi apprendre à travailler avec la volatilité des prix, en utilisant de nouveaux outils, comme l’épargne de précaution, l’assurance récolte ou l’instrument de stabilisation du revenu (ISR), sur lequel nous travaillons au sein de l’interprofession.
Quel est le rôle de la CGB dans ce nouvel environnement ?
Comme on le voit, la fin des quotas, c’est davantage d’incertitudes et de risques. Notre secteur connaît une mutation sans précédent dans laquelle les planteurs doivent continuer à faire entendre leur voix. C’est ce que fait la CGB sur l’évolution des modes de production, la contractualisation, la gestion des risques et le développement durable des débouchés de notre filière.
Propos recueillis par Adrien Cahuzac et François-Xavier Duquenne