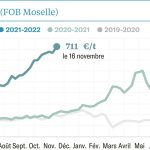Verdir le carburant des avions grâce à l’agriculture : cette ambition portée par le secteur de l’aéronautique se concrétise sur le terrain. Après le colza pour le biodiesel, c’est désormais la cameline, notamment en culture dérobée, qui fait l’objet de convoitise. Car il n’est pas question de faire concurrence aux objectifs nourriciers des sols. C’est donc dans ce contexte que l’idée de cultiver la cameline pour diversifier les systèmes de culture s’est matérialisée en un projet européen, baptisé Carina, sur lequel Terres Inovia, Arvalis et Saipol planchent en France. Plusieurs modalités de culture de cette plante oléagineuse sont ainsi passées au crible : en interculture, en association de culture, ou encore sur des terres à plus faible potentiel. Terres Inovia a pris part au projet pour étudier le contexte global de la cameline, au travers de ses grandes caractéristiques agronomiques, de ses débouchés, et de la manière de l’insérer dans les systèmes culturaux. « L’originalité de cette crucifère encore peu présente sur le territoire réside dans son cycle court, de l’ordre de 90 à 100 jours, qui lui confère une opportunité en culture dérobée, explique Domitille Jamet, chargée d’étude en systèmes de culture et agronomie au sein de Terres Inovia. La cameline est rustique car elle est peu exigeante en eau et en intrants, peu sensible aux températures élevées sauf au-delà de 35°C et résistante aux bioagresseurs. Elle valorise les sols à faible potentiel et son itinéraire technique à faible coût émet peu de gaz à effet de serre. »
Le choix du précédent est capital
Les essais menés chez des agriculteurs ont permis d’acquérir des références sur la conduite technique et des données technico-économiques. En culture dérobée estivale, la cameline s’implante fin juin ou début juillet, et se récolte à partir de fin septembre et jusqu’au 20 octobre pour pallier les difficultés de séchage. Le choix du précédent cultural a donc son importance puisqu’il doit être récolté suffisamment tôt, afin de semer la cameline. Une opération qui s’effectue idéalement avec un semoir à semis direct à dents dans les 48 heures qui suivent la récolte, dans l’optique d’assurer une levée optimale. Cette dernière nécessite un arrosage, soit naturel avec des précipitations efficaces, soit une irrigation. D’un point de vue économique, les essais montrent une meilleure valorisation dans le cas d’un semis direct de cameline en dérobée après des pois d’hiver, avec une marge brute positive obtenue dès les six quintaux de rendement, si le prix de vente est de l’ordre de 600 € la tonne. Dans le cadre d’un semis en techniques culturales simplifiées après une orge d’hiver, il sera nécessaire d’obtenir a minima 8 quintaux/ha pour viser une marge brute positive.
D’autres manières d’introduire la cameline sont également mises au banc d’essai : en association avec, par exemple, de la lentille ou du lin, en dérobée hivernale avec un semis en octobre et une récolte fin mai ou début juin, ou encore en culture principale, que ce soit en semis d’automne ou de printemps. Enfin, en ce qui concerne les débouchés de la cameline, en dehors du biokérosène, l’huile des graines peut être valorisée dans l’alimentation humaine et animale, la cosmétique ou les composés chimiques. Les tourteaux peuvent être destinés à l’élevage, tandis que les pailles et résidus présentent un intérêt dans le secteur des matériaux (papier, béton, isolation).