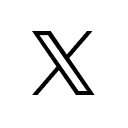Un article de notre partenaire européen Euractiv.
Emmanuel Macron martèle cette idée depuis longtemps ; au G7 de Biarritz en août 2019, au Salon international de l’agriculture à Paris en janvier 2020 et même lors de son allocution télévisée le 12 mars dernier. Après maintes exhortations, une stratégie pour réduire les importations françaises de protéines végétales est enfin sur la table. Figurant au sein du plan de relance, le plan protéines végétales bénéficie d’une grosse enveloppe, 100 millions d’euros, qui devrait permettre « de bâtir notre souveraineté alimentaire » en diminuant « fortement l’importations de protéines destinées à l’élevage », selon le communiqué du gouvernement.
Une production européenne fragilisée
Colza, soja, tournesol, fèves, légumineuses : les éleveurs ont recours à de nombreuses protéines végétales pour nourrir leurs bêtes et assurer leurs rendements. Selon le rapport 2018 de la Commission sur le développement des protéines végétales dans l’Union européenne, le bloc importe chaque année près de 17 millions de tonnes de protéines brutes. 13 millions sont à base de soja, dont la teneur protéinique en fait l’aliment incontournable des élevages porcins, bovins et avicoles. Si la France fait partie des pays européens qui produisent le plus d’oléagineux – notamment en colza et en tournesol -, son indépendance est loin d’être acquise. En 2018, trois millions de tonnes de tourteaux de soja ont été importés dans l’Hexagone. Malgré quelque 400 000 tonnes de graines de soja cultivées en France, près de 600 000 ont été importées en provenance notamment du Brésil, des États-Unis d’Amérique et d’Argentine.
Passés maîtres dans la culture d’oléagineux, les pays américains proposent des graines et du tourteau à des prix très avantageux. Face aux semences américaines génétiquement modifiées, capables de résister aux insecticides les plus corrosifs, les agriculteurs français tirent difficilement leur épingle du jeu. « Les graines de soja argentines, les lentilles canadiennes et indiennes, ou le tourteau de soja américain sont loin de respecter un cahier des charges européens », assène Jean-René Menier, exploitant agricole du Morbihan et élu de la Fédération française des producteurs d’oléagineux et protéagineux. « En France, nous ne pouvons pas nous permettre de brader nos cultures alors que nous suivons déjà des règles de productions extrêmement strictes. »
Sursaut de souveraineté nationale
Souveraineté nationale, enjeu environnementaux, défis sanitaires : les arguments pour développer une culture européenne des protéines végétales ne manquent pas. Mais l’entreprise est titanesque tant l’Europe est à la traîne. Derrière cette dépendance européenne vis-à-vis des importations américaines se cachent des raisons historiques et de longues années de tractations commerciales. Après la Seconde Guerre mondiale, lors des négociations du GATT (ancêtre de l’OMC) sur les tarifs douaniers et le commerce, une spécialisation des pays agricoles voit le jour : aux Américains les protéines végétales, aux Européens les cultures céréalières. Si la culture du colza et du tournesol s’y est peu à peu développée dans les années 1970, l’Europe est toujours pieds et poings liés aux géants américains. L’écart se creuse davantage après les accords de Blair House en 1992, où Washington obtient le plafonnement des surfaces européennes consacrées au soja, colza et tournesol à 5,1 millions d’hectares. Bien en deçà des besoins du vieux continent.
Loin de la révolution verte
Une pandémie mondiale plus tard, les États européens ont pris conscience des risques que posent la dépendance aux importations étrangères. Lors du Conseil informel des ministres de l’agriculture, le 1er septembre dernier, le ministre français Julien Denormandie a accordé un point d’honneur à « la souveraineté alimentaire européenne », qui doit passer par « la sécurisation des approvisionnements et le développement de l’autonomie stratégique de secteurs comme les protéines végétales ».
En attendant une stratégie européenne, le plan de protéines végétales français a été bien accueilli. « Nous sommes ravis, car nous l’attendions depuis longtemps », rappelle Jean-René Menier, qui propose d’établir des contractualisations, liant les agriculteurs des plaines du centre de la France aux éleveurs bretons : « Ils produisent et on achète. Tout le monde s’en tirerait à bon compte. »
Le développement d’une production nationale et sans OGM de protéines végétales pourrait soulager des agriculteurs qui cumulent difficultés économiques et défis climatiques. Mais est-ce pour autant une mesure écologique ? Samuel Duglas, éleveur bovin en Ille-et-Vilaine, en doute. « Réduire nos importations étrangères n’est pas une mauvaise initiative en soi. Mais pour qui va-t-on produire ces protéines végétales en France ? Pour l’élevage hors-sol et intensif qui a besoin de teneurs protéiniques exceptionnelles afin d’obtenir des rendements faramineux. Réduire les importations de protéines végétales, très bien, mais si c’est pour encourager un système de production qui bousille nos eaux et nos terres, sans même assurer un salaire décent aux fermiers, je ne vois pas trop l’intérêt. »
Voilà maintenant huit ans que cet exploitant agricole brétilien n’achète plus aucune protéine végétale. Son cheptel de 75 têtes dispose d’une cinquantaine d’hectares de prairies, d’où ses vaches tirent les protéines nécessaires à leur lactation. À l’aide de l’association Adage 35, qui milite pour une agriculture durable et autonome, Samuel Duglas est passé à l’agriculture biologique en 2010, même si sa « vraie transition » reste le passage au tout herbe : « Cela a totalement changé ma manière de travailler. Je ne cultive plus de maïs, plus de blé, fini les produits phytosanitaires. Bien sûr, au début, la transition peut faire peur. C’est là que l’Adage a été très utile. Elle m’a permis de me former, de rencontrer d’autres agriculteurs qui ont pu me conseiller. »
Ce Breton, installé à une quarantaine de kilomètres de Rennes depuis 2007, a « réussi » à réduire sa production de lait. De 10 000 litres par an, il n’en fourni plus que 5 000 désormais, sans que cela pose problème. « Bien sûr que mes rendements ont baissé, mais mes charges aussi. Je suis même passé à une seule traite par jour, et nous nous en sortons bien à la ferme, je passe plus de temps avec ma famille. Économiquement parlant, le pâturage tient la route », martèle l’agriculteur, qui bénéficie des prix avantageux que lui confère son label bio.
Au sujet du plan protéines végétales, l’agriculteur est persuadé, « ce n’est pas une mesure environnementale. Elle conforte l’élevage intensif, alors que tout le monde sait qu’il faut changer de système. On ne s’en sortira que si on sort de ces logiques de rendements ».