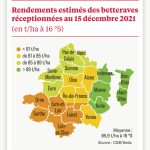Voici un oiseau en forme ! Les effectifs sont en constante progression un peu partout. Selon une étude de 2020, on dénombrait 27 774 nids et 1 787 colonies dans l’hexagone. Les effectifs ont considérablement augmenté depuis 1985, passant de 13 652 à 27 767. On note toutefois un tassement de 2014 à 2020 avec une baisse de 20 %, notamment en Picardie. Dans ce département, on observait 400 hérons nicheurs l’année de référence, contre 500 six ans auparavant. Notons toutefois que cette étude ne tient pas compte des oiseaux migrants.
Ce magnifique échassier fréquente la plupart des lacs, des marais, des rivières et des fleuves. Sa haute silhouette grise en bordure des joncs attire le regard. Si vous l’observez suffisamment longtemps, vous le verrez poignarder avec la rapidité de l’éclair le poisson qui passe à proximité. Mais il peut aussi saisir un caneton, un lapereau, une grenouille ou une écrevisse. Le bec est une arme redoutable. À l’époque où il était chassable (sa protection date de 1974), il fallait veiller à retenir le chien si l’oiseau était blessé. Autrement, il risquait de perdre un œil ! Le héron cendré s’acclimate fort bien sur les plans d’eau des jardins publics. Il fréquente ainsi les pièces d’eau du parc Monceau et du parc de Bagatelle à Paris. Les chasseurs de canards à la passée entendent de fort loin le coup de trompette de l’oiseau, qui vient passer la nuit sur les arbres en bordure de marais.
En colonies
Si le héron cendré chasse seul, il se reproduit en colonies, que l’on appelle des héronnières. On les observe le plus souvent dans les hauteurs des arbres d’un bois ou d’un boqueteau, en lisière de forêt, sur de petits saules au milieu des marais ou, plus rarement, dans les roseaux. Lors de la période de reproduction, le grand échassier se mélange volontiers aux autres espèces de hérons, aux ibis, aux cormorans ou aux spatules. Ils sont fidèles à leurs lieux de nidification d’année en année, pour peu qu’ils ne soient pas dérangés ou les arbres détruits. Les colonies peuvent compter plusieurs dizaines de nids.
Ils sont construits à la cime des arbres avec des branches et des branchettes, des racines et de la paille. Un nid est rénové et réutilisé d’une année sur l’autre.
La ponte a lieu entre mars et mai, et compte quatre œufs. La couvaison dure un peu plus d’un mois. À l’éclosion, les petits sont nourris avec de la nourriture régurgitée par les deux parents. Les jeunes les plus téméraires, âgés d’une cinquantaine de jours, quittent le nid progressivement et commencent leur apprentissage. Ils sont complètement indépendants à l’âge de trois mois.
Le héron cendré est un migrateur partiel. Les populations nicheuses du nord de l’Europe et de l’Europe continentale descendent vers le Sud pour passer l’hiver, tandis que celles de Grande-Bretagne, de France et de Belgique sont plutôt sédentaires. La France accueille ces migrateurs à partir de septembre. Les plus grands voyageurs atteindront l’Afrique tropicale.
Le nombre d’individus hivernants aurait doublé au cours des années 2000. Il était évalué à 100 000 en 2005.
Le développement de cette espèce a inquiété les pisciculteurs qui ont demandé aux pouvoirs publics de l’inscrire sur la liste des espèces pouvant être régulées. Mais ces derniers ont refusé, se bornant à demander à ces professionnels de se protéger par la pose de filets sur les bassins d’élevage.
Il est vrai que ses nuisances sont sans commun rapport avec celles des cormorans. D’abord parce que les oiseaux sont moins nombreux ; ensuite parce que leur régime n’est pas exclusivement piscivore.
Le plat favori d’Henri IV
Les hérons cendrés animent nos plans d’eau et leur majestueuse silhouette, qui descend en orbes vers leurs perchoirs, attire toujours la curiosité. Le plumage évolue en fonction de l’âge. Les jeunes sont moins colorés et plus frêles. Un grand vieux héron (photo) en action de pêche mérite toute notre attention. Le dos, gris bleu, est recouvert de fines aigrettes blanches, huppe noire, bandeau de corsaire, bec orange vif et un œil jaune qui semble absent alors qu’il perçoit la moindre vibration. L’oiseau semble pétrifié, ce qui rend surprenant sa vivacité quand il harponne.
Aux temps historiques, l’oiseau se chassait au faucon ou à l’autour. C’était même la cible favorite des oiseaux de proie royaux. Une fois « lié », il terminait sa vie sur la table princière. Au Moyen Âge, on le sert noyé d’épices, en compagnie d’autres volatiles comme le cygne, la cigogne, le cormoran ou le paon. La viande de bœuf, jugée vulgaire et abandonnée aux manants, ne fera son apparition qu’au siècle suivant. Dans son livre « l’histoire à table », André Castelot nous apprend que le roi Henri IV raffolait du héron cuisiné par « l’Hostellerie de La Tour d’Argent » déjà fort réputée. « Ses pâtés de héron étaient particulièrement savoureux. On y servait aussi des grues au jus de prunes, du paon aux amandes et l’on y rôtissait des cygnes », souligne l’auteur, lequel précise que le roi envoyait son maître d’hôtel chercher «de grosses tranches de son pâté de héron ».
Adolescent, quand j’accompagnais mon père à la chasse, il lui arrivait de tirer un héron. Je me souviens que nous faisions mariner les filets dans du vin rouge aromatisé et que le plat se laissait manger. Sans plus.
Nous n’avions sans doute pas la délicatesse de palais du bon roi Henri …