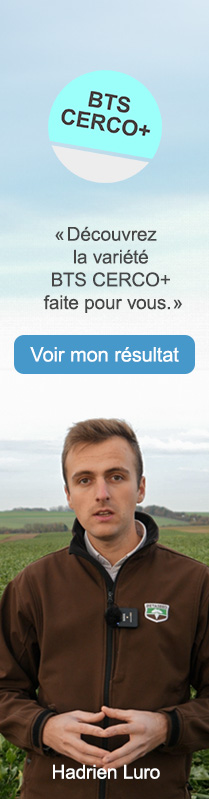Cercosporiose : une pression modérée
Les premières taches de cercosporiose ont été observées dès le 16 juin en région Centre et à partir du 23 juin dans les autres régions. Cette précocité a conduit aux premières interventions fongicides, qui se sont étalées jusqu’à début août (moyenne au 11 juillet). Les conditions climatiques ont ensuite ralenti le développement des maladies, si bien que le renouvellement des interventions n’a eu lieu qu’à partir de fin juillet pour un croissant allant du sud de Paris à l’est, et début août pour la Normandie et les Hauts-de-France. Une troisième intervention a été nécessaire dans 64 % des parcelles, en deuxième quinzaine d’août (moyenne au 23 aout). En moyenne 2,2 interventions fongicides ont été nécessaires pour contenir la maladie, avec une application supplémentaire systématique dans les zones à pression historique.
La pression de cette année dans le département s’avère, à la mi-septembre, la plus faible depuis les trois dernières années, malgré une apparition précoce de la cercosporiose, ayant conduit à 3 applications fongicides. En effet, les premières interventions ont été déclenchées dès la mi-juillet. Les pluies de la fin du mois ont par la suite favorisé un développement soutenu de la maladie, entraînant le renouvellement de la protection début août. La maladie a été ensuite contenue par les conditions sèches d’août et de début septembre (moins de 40 mm sur la station de Laon sur la période concernée), si bien que les 3èmes interventions n’ont concerné que les arrachages les plus tardifs (après le 15/10). Le choix de variétés tolérantes pour ces arrachages, désormais bien ancré dans les pratiques des betteraviers, permet également de contenir la gravité de la cercosporiose. Autre maladie observée dans une parcelle sur deux dans le département : la rouille, mais sans jamais atteindre le seuil de déclenchement.
Chaque semaine, dès le 15 juin dans les zones les plus précoces, et jusqu’à la récolte, les observateurs prélèvent 100 feuilles pour compter celles atteintes par chaque maladie foliaire. Ces observations sont ensuite saisies dans l’outil Vigicultures et, après validation, servent à établir un bilan sanitaire dans le Bulletin de Santé du Végétal. Lorsque le seuil est atteint pour l’une des maladies, une intervention fongicide peut être déclenchée. Les données alimentent en temps réel l’outil Alerte, et contribuent au paramétrage de modèles.
Des dégâts de teignes majoritairement en Champagne
Les teignes ont été observées uniquement à partir du 24 juin, principalement en Champagne. Leur développement n’a repris qu’avec l’installation d’un temps plus chaud et sec à partir du 8 août.
• 33 % de sites ont été attaqués, en Champagne, au sud de Paris et dans quelques secteurs du nord-est de Paris.
• Parmi ces sites, 67 % ont atteint le seuil de déclenchement, en moyenne au 16 août.
Des dégâts de charançons majoritairement au sud de Paris
Les premiers adultes ont été observés au sud et à l’est de Paris dès le 9 mai, mais leur développement s’est surtout intensifié à la faveur des pics de chaleur du 19 juin puis du 8 août. Malgré 61 % de sites présentant des piqûres, des galeries dans les racines n’ont été observées que dans 34 % des sites, principalement au sud de Paris. Cela a concerné en moyenne 26 % des betteraves, et jusqu’à 100 % dans certaines parcelles de la région Centre.
Sur l’ensemble du territoire champenois, l’année 2025 s’est traduite par une pression teignes assez forte mais plutôt tardive. Les premières chenilles ont été observées courant juillet, leur développement se généralisant à partir de la mi-août. Les chaleurs et le stress hydrique prolongé en août, ayant réduit le bouquet foliaire, ont été particulièrement favorables à leur propagation. Sur la dernière décennie, une pression significative de teignes est recensée près d’une année sur deux. Au-delà du retard de croissance, les blessures au collet des betteraves sont des portes d’entrée potentielles pour le Rhizopus en périodes caniculaires. Sur ce point, les observations restent ponctuelles depuis une dizaine d’années. Des symptômes de charançons Lixus Juncii ont été remarqués à partir de début juin puis régulièrement au cours du cycle végétatif, notamment lors des pics de chaleur. Comme souvent, les observations sont plus importantes sur la zone sud du territoire champenois. Toutefois, le risque de perte de productivité semble limité, les migrations de larves vers les racines de betteraves restant ponctuelles. En effet, les observations minutieuses mettent en évidence plusieurs constats : les piqûres ne sont parfois que des tentatives de pontes, les avortements d’œufs sont fréquents et la mortalité des larves peut être précoce avec un déplacement restreint aux pétioles.
Réémergence des cicadelles, vectrices du SBR et du RTD
Depuis le retour du SBR en 2023 en Alsace, les suivis ont été renforcés à la fois sur les cicadelles, et sur les maladies bactériennes qu’elles transmettent : Syndrome des basses richesses (SBR) et Rubbery Taproot Disease (RTD). Même si diverses cicadelles ont été observées, aucun individu de l’espèce Pentastiridus, principale vectrice du SBR, n’a été capturé en dehors de l’Alsace. Toujours en dehors de cette région, aucune parcelle n’est actuellement touchée par du SBR ou du RTD. En revanche, dans cette région, la présence des cicadelles Pentastiridus et du SBR est confirmée.
À la suite de l’observation de SBR en Alsace en 2023, la pose de pièges englués a confirmé la présence, depuis deux ans, de cicadelles Pentastiridius leporinus, vectrices de la maladie. La présence de symptômes de SBR reste toutefois limitée, avec moins de 5 % des parcelles du bassin betteravier alsacien touchées à ce jour. L’impact du SBR apparaît, cette année, très hétérogène, avec des pressions allant de 1 à 2 %, jusqu’à 60 % dans les parcelles les plus atteintes. Par ailleurs, le RTD, n’a pas été observé dans la région, mais il reste sous surveillance. Le meilleur moyen de gestion consiste à maintenir les populations de cicadelles à un faible niveau. Ainsi, il est recommandé aux agriculteurs d’implanter après la betterave une culture d’été plutôt qu’une céréale d’hiver.
Pour la 3ème année consécutive, les noctuelles défoliatrices ont atteint le seuil d’intervention dans moins de 10 % des sites atteints. De plus, cette année, elles ont été observées dans 61 % des parcelles du BSV touchant en moyenne 12 % des betteraves, loin des 75 % de sites atteint pluriannuellement.
Quelques dégâts de punaises ont été relevés, dans 4 % des parcelles du réseau, provoquant des jaunissements pouvant être confondus avec des dégâts de jaunisse.