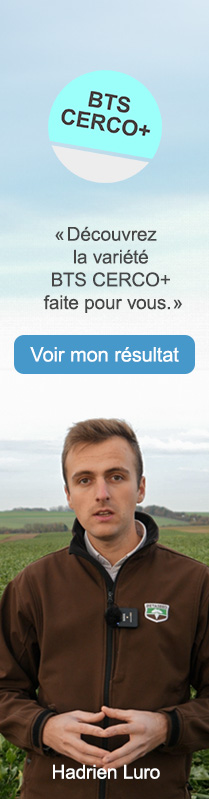Avec des chiffres allant du simple au triple, en fonction des parcelles et des départements, les rendements s’illustrent cette année par leur grande hétérogénéité. En Seine-et-Marne, la jaunisse n’a pas retenu ses coups. « Je suis à 57 t/ha en moyenne, l’année dernière j’étais à 72 t/ha, on ne peut pas continuer à jouer à la roulette russe », déplore Cyrille Milard, le président de la CGB Île-de-France, et planteur seine-et-marnais, à l’occasion d’une visite de terrain organisée à Courpalay, le 4 novembre. Selon lui, l’équilibre économique « extrêmement précaire » des planteurs du département, découlant d’un arsenal de solutions très limité depuis l’interdiction des néonicotinoïdes en 2018, remet sérieusement en cause la culture de la betterave localement. « Aujourd’hui, nous avons les mêmes produits qu’en 2020, rappelle Fabien Hamot, le secrétaire général de la CGB. Tous les ans, quand je sème, j’investis 3 000 €/ha, avec tous ces risques. Nous sommes dans un marché commun, mais nous n’avons pas les mêmes règles de production. Nous subissons une perte de production et de productivité qui profite à nos concurrents, comme la Pologne. »
Depuis le lancement du PNRI (plan national de recherche et innovation) en 2021, des pistes alternatives ont bien été identifiées, notamment des solutions de biocontrôle mais, pour l’heure, aucune solution économiquement viable et opérationnelle n’a été consolidée. « C’est frustrant de savoir qu’il y a des agriculteurs qu’on ne peut pas aider aujourd’hui », admet Fabienne Maupas, directrice du département technique et scientifique de l’ITB, et membre du comité scientifique du PNRI.
Des enseignements sur les contaminations tardives
Si l’ensemble des sélectionneurs a identifié des phénotypes résistants à la jaunisse, les premières variétés résistantes ne sont pas attendues avant 2030. Les travaux du PNRI-C, deuxième mouture du plan de recherche lancé en 2023 se focalisent donc sur les pucerons. « L’année 2025 s’est distinguée par des vols massifs et tardifs de pucerons noirs, réputés pour être de très bons vecteurs du virus BYV. Nous commençons à comprendre que la contamination a pu se faire au-delà du stade des 12 feuilles, et que nous faisons prendre un risque aux agriculteurs en leur préconisant de ne pas traiter après ce stade », détaille Fabienne Maupas.
L’ITB, tout comme l’Inrae, souligne par ailleurs le risque de développement de résistance chez les pucerons, lié au recours répété aux mêmes produits, également utilisés dans d’autres filières. Pour favoriser une gestion collective de la problématique, un projet inter-filière a été déposé auprès du Parsada, auquel participe notamment Arvalis ou Terres Inovia. Sa validation est attendue d’ici à la fin de l’année. « Les réservoirs de pucerons viennent majoritairement des crucifères, rappelle Fabienne Maupas. Nous devons limiter les réservoirs viraux en adoptant une approche inter-filières et collective. »