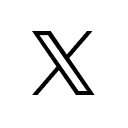« Mes parents ont été expropriés d’une bonne partie de notre ferme d’origine car elle se situait dans la ville nouvelle de Cergy-Pontoise », se rappelle Denis Fumery. Entre l’expropriation et la construction de la ville, l’État leur a accordé le statut d’occupant précaire. « Cela signifie qu’ils pouvaient continuer à cultiver les terres mais que les bulldozers pouvaient venir la veille de la moisson et commencer leur chantier dans la culture », explique Denis Fumery qui s’est installé dans une ferme dont 75 % des terres avaient ce statut. « Je savais que je ne cultiverais pas mes terres jusqu’à la retraite et que je serais obligé de partir », se rappelle-t-il. Mais cela n’a pas effrayé l’agriculteur qui avait intégré le besoin de souplesse et d’adaptabilité que la situation exigeait. « Mon père bougeait facilement. Moi aussi, et j’ai fait différents métiers avant de m’installer ».
Au fur et à mesure que la ville de Cergy s’est construite, il a dû quitter une bonne partie de sa ferme. « Le parcellaire que je cultive aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celui que j’avais à mon installation », explique-t-il, alors qu’il exploite encore quelques parcelles en occupation précaire depuis 50 ans.
Heureusement, plusieurs agriculteurs voisins qui ont cessé leur activité lui ont transmis une partie de leurs terres. Il a pu donc continuer son activité en augmentant même un peu sa surface. Alors que la viabilité de son exploitation agricole a été plus que compromise, il est en train de passer la main sereinement à son fils.
Autre inconvénient de sa position géographique : la pression de pigeons venant de la ville sur les semis de tournesol, tout en rendant l’effarouchement sonore plus compliqué, voire impossible par endroits, en raison des nuisances vis-à-vis des riverains.
De la paille pour les chevaux
Heureusement, l’agriculture périurbaine a aussi quelques atouts. La proximité avec un certain nombre de centres équestres est, par exemple, un avantage. Denis Fumery presse toute sa paille et la commercialise auprès de l’un d’entre eux, qu’il alimente deux fois par semaine. Il récupère un fumier très pailleux qu’il composte pendant deux ans avant de l’épandre. « Le revenu net de cette activité m’a permis de m’équiper d’un télescopique et de payer une partie d’un salariat à plein temps ».
Rencontre ville-campagne
Denis Fumery a beaucoup d’engagements à l’extérieur de son exploitation, comme au sein de la CGB par exemple. Parmi eux, il s’investit dans la communication agricole auprès du grand public, via l’association Rencontre Ville-Campagne. Il intervient dans les écoles, mais aussi au sein d’entités comme la Mutualité sociale agricole (MSA), afin d’expliquer son métier. Pour lui, les tensions entre les agriculteurs et les habitants des villes sont liées, entre autres, à la méconnaissance grandissante de l’agriculture. « Aujourd’hui, il est important et nécessaire de communiquer tous azimuts ».
L’âge d’or du pois protéagineux
Denis Fumery a cultivé beaucoup de pois jusque dans les années 2000. « On avait des super rendements au début. On faisait du 70 – 75 qx par hectare », explique l’agriculteur en précisant être monté jusqu’à 120 hectares de pois sur 310 hectares, soit 39 % de sa surface agricole utile (SAU). « J’ai bien gagné ma vie grâce au pois », affirme-t-il, alors que cette culture a maintenant perdu beaucoup de son prestige en France. Sur certaines parcelles, le pois revenait tous les 2 ans, en alternance avec du blé. L’agriculteur s’était équipé d’un pick-up Sund dédié spécifiquement à la récolte des pois afin de récolter la culture quand elle était couchée. « Il fallait attendre que les pois soient en surmaturité, et le pick-up arrachait les plants plus qu’il ne les coupait », se souvient-il. « Cela marchait très bien ».
« La SAU dédiée à cette culture a commencé à diminuer quand on a eu des printemps humides qui ont apporté l’aphanomyces. Il est vrai qu’on a fait trop de pois », reconnaît l’agriculteur. Par ailleurs, il postule que la recherche variétale a privilégié la résistance à la verse au potentiel de rendement. « On a eu des variétés qui ne se plaquaient plus, mais qui n’avaient pas le même potentiel », explique-t-il.
Aujourd’hui, il a arrêté cette culture mais produit des féveroles de printemps sur 25 hectares environ. Cependant, le rendement moyen plafonne à 35-40 qtx/ha et la marge est bien inférieure à celle des pois à leur apogée. « Ils sont plus sensibles aux sécheresses de fin de cycle », remarque Denis Fumery.
Originalité de son système : il positionne systématiquement la légumineuse avant la betterave. En effet, il considère que la betterave valorise mieux l’azote résiduel de la féverole qu’une autre culture. Par ailleurs, le colza est exclu des rotations où il y a de la betterave.
> À lire aussi : Antoine Chedru, l’agriculture de conservation contre l’érosion (13/10/2023)
> À lire aussi : Hervé Lapie, l’agriculture en commun (02/09/2023)