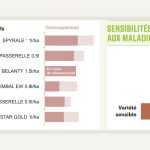Connaître la fertilité des sols passe par l’étude de la matière organique. Mais parler de la matière organique au singulier s’avère trop simpliste. La vision de la matière organique ne peut être statique. Elle s’inscrit dans un cycle. En fait, il n’y a pas une, mais des matières organiques avec des fonctions différentes.
L’origine de la matière organique est le végétal. La matière organique (MO) fraîche va finir stabilisée en humus. On distingue la MO labile, fraction facilement biodégradable, de la MO stable, à biodégradation très lente. Le carbone labile alimente les organismes vivants du sol : bactéries, champignons, collemboles. Autant d’acteurs du sol vivant indispensables au bon état biologique de celui-ci.
Aujourd’hui, les données d’une analyse de sol classique (teneur en MO du sol et rapport C/N) ne suffisent pas. Au laboratoire, nous disséquons les différentes matières organiques par fonction. Un compartiment MO végétale, un autre MO en transformation et, enfin, la matière organique énergétique.
Des matières organiques aux fonctions différentes
La première approche peut diviser la matière organique selon la taille. La petite en dessous de 50 µm (taille des argiles) et la grossière supérieure à 50 µm. La MO libre se constitue de résidus végétaux, facilement assimilable à la vie du sol (couvert végétaux, apports).
La MO liée représente 85 à 90 % de la MO. Elle est protégée par des protections fines (des argiles). Elle participe aux propriétés de structure du sol.
Ensuite, nous pouvons séparer la MO vivante de la MO morte. La MO vivante (la biomasse microbienne) représente seulement 2 % de la MO totale. Mais si elle n’est pas là, le système ne fonctionne pas. Constituée à 90 % de bactéries, elle s’avère indispensable. Limiter le travail du sol la favorise. Et enfin, nous pouvons estimer la partie digestible, la MO énergétique. Elle permet la minéralisation du carbone et de l’azote.
Ces quatre compartiments interagissent entre eux. La biomasse microbienne utilise la MO libre pour minéraliser le carbone et l’azote. Les bactéries et les champignons ont un rôle très important. La MO liée va minéraliser beaucoup plus lentement (voir schéma).
Connaître les flux entre les différents compartiments permet de comprendre le cycle et de savoir quel type de MO apporter.
Des indicateurs pour caractériser ses apports organiques
Si le C/N donne une indication, il ne suffit pas. Il faut aussi s’intéresser à l’ISMO, indicateur de la résistance à la biodégradation. Il s’exprime en pourcentage de la matière organique brute. Plus il est élevé, plus sa MO enrichit le sol en humus. Cette caractéristique est obligatoire pour tous les produits vendus avec des quantités supérieures à 3 500 tonnes (composts, fientes…). Souvent, il faut la demander aux fournisseurs. Pour les effluents d’élevage, de nombreuses synthèses donnent des moyennes par type.
Ainsi, deux matières comme les fientes et le digestat peuvent avoir un C/N proche et un ISMO différent. L’ISMO caractérise mieux la stabilité de la matière organique et sa biodégradabilité. Le C/N seul n’indique pas la disponibilité de la MO. Si le produit a été chaulé, les données changent (2).
Le fumier comprend environ la moitié de MO liée et la moitié assimilables. Il stimule la vie du sol. Le compost ne stimule pas la vie du sol, il l’entretient. Il permet un stockage du carbone dans le sol. Le digestat brut a des caractéristiques proches.
En connaissant les différents compartiments de la MO déficients, l’agriculteur peut rectifier ses apports organiques. Il privilégiera du compost et du digestat en cas de déficit de MO liée. Si le déficit se trouve dans la MO libre, il préfèrera des apports en fumier pailleux ou en bois raméal fragmenté (BRF) pour stimuler la biomasse microbienne. Enfin, des apports en carbone minéralisable du type lisier, boues, vinasse et couverts végétaux sont très bons pour pallier un déficit de carbone minéralisable.
En conclusion, les MO ont deux rôles essentiels. Le support et le gîte avec la MO humifiée ; la nutrition et le couvert avec la MO labile. L’agriculteur peut optimiser les apports en choisissant une MO adaptée. En terme de bilans de MO, ils sont les mêmes en système labour ou non labour. En TCS, la matière organique se concentre plus sur les horizons de surface. En année humide, le système conventionnel consomme autant de carbone. En année sèche, le système labour a un moins bon fonctionnement de la consommation de MO. Mais sur vingt ans, le bilan est le même.
_____________
(1) Intervention lors de l’Agroforum organisé par Agora en février.
(2) Si on chaule un produit (boue…), cela le stabilise et le rend moins biodégradable. Il se dégradera après la couche de calcaire les entourant.
Coût d’une analyse de MO complète : 270 €. Et 300 € avec l’analyse chimique .
Les différentes MO ont des vitesses de renouvellement différentes. La MO libre se vide en 15 ans (6 à 7 % sont utilisés tous les ans). Pour la MO liée, il faut 50 ans pour la produire et 50 ans pour la déduire. Soit un amortissement de 2 % par an. La biomasse microbienne se recharge rapidement (un an). Celle de la minéralisation demande 4 à 6 mois. Elle indique s’il y a suffisamment d’énergie. Connaître les flux entre les différents compartiments permet de comprendre le cycle et de savoir quel type de MO apporter.