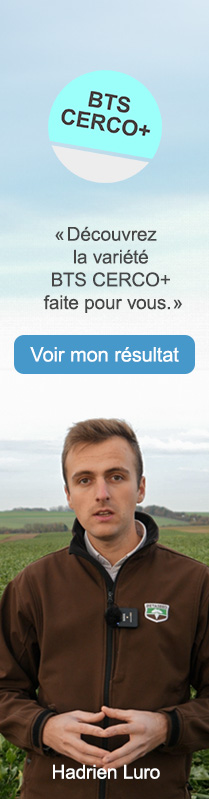Quelle analyse faites-vous du parcours de la loi qui porte votre nom ?
La pétition contre la loi sur les contraintes est l’illustration que la gauche ne renonce jamais. Elle a d’abord déposé 3 500 amendements en espérant bloquer le parcours du texte, mais la motion de rejet que nous avons déposée a permis d’échapper à ce piège. Je note d’ailleurs que le Conseil constitutionnel a validé cette procédure. Le texte s’est donc retrouvé en Commission mixte paritaire où 95 % du temps de parole a été occupé par deux députés suppléants, Monsieur Biteau pour les Écologistes et Madame Meunier pour LFI. La présidente de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale, Madame Trouvé, qui est aussi LFI, a même dit que les débats s’étaient déroulés dans un cadre plutôt positif. En Commission mixte paritaire, le texte a été voté par 10 voix contre 4, ce qui fait quand même une large majorité. Puis le texte a été voté avec 93 voix d’écart à l’Assemblée nationale. On se retrouve donc avec un texte qui a été voté par 70 % des sénateurs et 60 % des députés ! Et malgré cela, l’extrême-gauche et les Écologistes ont déporté le débat dans la rue et instrumentalisé une pétition lancée par une jeune fille que personne ne connaît et qui d’ailleurs ne répond à aucun journaliste. Il est intéressant de voir que cette pétition est déposée le 10 juillet et qu’il ne se passe rien jusqu’au 17 juillet. Tout le système des réseaux sociaux se met en route entre le 17 juillet et le 23 juillet, et on arrive à 2 millions de signatures.
Comment expliquez-vous le succès de cette pétition ?
Cette pétition a été alimentée par les contributions faites au Conseil constitutionnel par toutes les associations bien-pensantes, soit écologistes, soit de gauche ou d’extrême-gauche et toutes les associations de médecins et autres qui ont été instrumentalisées par quelques influenceurs. Résultat, la pétition est arrivée à prendre 500 000 signatures par jour à ce moment-là. Après, pourquoi s’arrête-t-elle à 2 millions ? On retrouve un peu la même similitude que pour la signature de la pétition contre l’inaction climatique début 2019. Je ne dis pas que ce sont exactement les mêmes personnes qui ont signé, parce qu’il y a un élément nouveau dans cette affaire, puisqu’on a aussi agité la peur vis-à-vis de la santé. Sur les réseaux sociaux, l’acétamipride a été présenté comme dangereuse pour l’homme, l’environnement et les abeilles.
Quel a été selon vous le rôle de cette pétition ?
En fait, je pense qu’elle a mis la pression sur le Conseil constitutionnel. Ils y sont en partie arrivés. En partie seulement, car le Conseil constitutionnel a quand même validé 80 % du texte, soit 5 articles sur les 6. En réalité, nous sommes largement au-dessus des 80 %. Parce que dans l’écriture de l’article 2, il y avait d’autres choses que la réintroduction de l’acétamipride. Il y avait aussi la priorisation des dossiers par l’Anses, quand on se retrouve en situation de crise. Cette possibilité a été enlevée de la loi, mais reprise par un décret de la ministre de l’Agriculture.
Quelle lecture faites-vous de la censure du Conseil constitutionnel ?
Ce n’est pas tout à fait une censure, car le Conseil constitutionnel ne censure pas sur le fond la réintroduction de l’acétamipride en invoquant la Charte de l’environnement. Si cela avait été le cas, c’était la fin de l’histoire. Le Conseil constitutionnel ne censure pas l’idée de réintroduire l’acétamipride. En revanche, il dit : vous n’avez pas suffisamment encadré sa réintroduction. C’est relativement paradoxal, parce que je vous rappelle qu’en 2020, ce même Conseil constitutionnel avait validé le processus de réintroduction d’une molécule qui s’est avérée interdite en Europe. Aujourd’hui, c’est totalement différent, la molécule est autorisée par l’Europe.
Le Conseil constitutionnel ne ferme donc pas complètement la porte. Allez-vous refaire une proposition de loi plus encadrée ?
C’est vrai, le Conseil constitutionnel ne ferme pas la porte et donne même les clés pour écrire un nouveau texte. Il nous dit trois choses : vous n’avez pas encadré la durée, vous n’avez pas cité les filières et vous n’avez pas donné les modes d’utilisation du produit. Cela paraît quand même incroyable parce que là, on entre dans une grande technicité. Je ne suis pas sûr que les neuf Sages connaissent les différentes méthodes de pulvérisation. Mais soit. Si l’on prend la première remarque sur le délai, là aussi, c’est paradoxal parce qu’en 2020, le Conseil constitutionnel avait autorisé pour trois ans une molécule interdite. Alors que mon texte l’autorisait par dérogation et disait surtout que, si une méthode alternative ou une nouvelle molécule moins dangereuse se présentait, la dérogation devait tomber immédiatement. Je ne m’interdis pas de réécrire un texte de façon à répondre aux critères énoncés et passer la barre du Conseil constitutionnel.
Qu’est-ce qui fera que vous sauterez le pas ?
Le problème, c’est que l’on risque de rentrer dans une période relativement instable. Il faut attendre que la situation politique s’éclaircisse. En revanche, cela ne m’empêche pas de travailler sur la possibilité d’écrire un texte qui réponde aux critères du Conseil constitutionnel. On ne peut pas baisser les bras. Je ne peux pas me résoudre à laisser les agriculteurs face à une concurrence déloyale. Car en même temps que le Conseil constitutionnel censurait mon texte, la Commission européenne autorisait le relèvement du seuil de limite maximum de résidus d’acétamipride dans les produits alimentaires. Par exemple, le seuil pour le miel a été relevé de 6 fois, passant de 0,05 mg/kg à 0,3 mg/kg. Et l’Efsa proposait même de la porter à 1 mg/kg de miel, soit 20 fois plus ! Comment peut-on refuser les moyens de production aux agriculteurs français tout en fermant les yeux sur les aliments importés, qui sont produits avec les méthodes que nous interdisons ? C’est d’une naïveté totalement coupable.