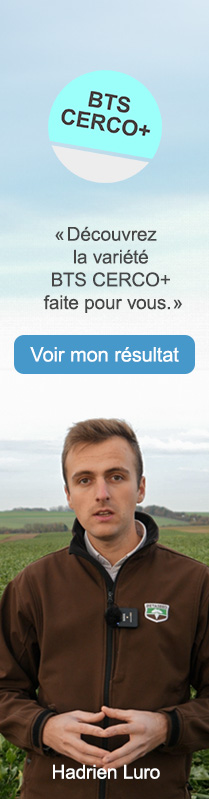La PAC prend-elle le bon chemin ? Les annonces du mois de juillet dernier, de part et d’autre de l’Atlantique, peuvent donner matière à réflexion.
Du côté américain, le One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) promulgué par Donald Trump, le 4 juillet dernier, contient des dispositions relatives à l’agriculture visant à soutenir les farmers et plus particulièrement les grandes cultures.
Tant en termes de financement que de vision, le contraste est frappant avec la proposition de la Commission européenne dévoilée deux semaines plus tard, le 16 juillet.
Le décalage s’accentue entre la PAC et la politique agricole américaine, et malheureusement il n’est pas en faveur des agriculteurs européens. « Les propositions pour la nouvelle PAC sont en décalage par rapport aux autres politiques des grandes parties du monde, à savoir des soutiens plus élevés pour leurs agriculteurs et une considération forte concernant l’aspect stratégique de l’agriculture et de l’alimentation », note Élisabeth Lacoste, directrice de la Confédération internationale des betteraviers européens (CIBE).
Alors que le budget proposé pour la PAC 2028-2034 est en baisse de 17,6 %, les États-Unis prévoient de leur côté d’augmenter les dépenses agricoles d’environ 65,6 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie (2025-2034) selon le US Farm Bureau, principal syndicat des agriculteurs.
« La principale différence entre le Farm Bill (modifié par l’OBBBA) et la PAC réside dans les outils pour absorber les chocs et les crises de marché ou climatiques. Il s’agit d’outils assurantiels et de filets de sécurité. Ceux-ci sont plus solides, simples à déclencher, et mieux financés aux États-Unis. Avec le One Big Beautiful Bill Act, les divergences de ce point de vue augmentent », poursuit Élisabeth Lacoste.
Renforcement des filets de sécurité
La loi américaine prévoit une hausse des prix de référence pour les principaux produits de base d’environ 10 à 21 %. C’est ce prix de référence qui déclenche le versement de subventions dans le cadre des programmes de soutien des prix et des revenus.
Le Farm Bill met donc davantage l’accent sur la sécurité du revenu, la stabilité et la compétitivité, plutôt que sur des paiements découplés, prévus en baisse dans la PAC et liés au respect derégulations environnementales strictes.
Aux États-Unis, le sucre bénéficie d’un système spécifique. Il n’est pas inclus dans la liste des produits de base (blé, maïs, soja…) mais son marché intérieur est protégé. Les producteurs américains de canne à sucre et de betterave bénéficient d’un programme de contrôle de l’offre qui limite, d’une part les importations annuelles des États-Unis à environ 2 Mt et, d’autre part, la production intérieure à environ 10 Mt, grâce à un système de quotas. Ce double mécanisme, qui garantit des prix intérieurs du sucre relativement élevés, est complété par un programme de soutien des prix dans le cadre d’achat du sucre brut et du sucre raffiné par le gouvernement fédéral à un taux de prêt défini, ainsi que par un programme « sucre vers éthanol » en cas de surplus.
L’OBBBA a encore augmenté ces taux : de 19,75 cents à 24 cents la livre pour le sucre de canne brut (+21,5 %) et de 25,4 cents à 32,77 cents la livre pour le sucre de betterave raffiné (+29 %). Au taux en vigueur, cela correspond à un prix garanti, pour le sucre, supérieur à 610 €/t !
« L’administration Trump a relevé le filet de sécurité de façon assez significative ; il a pris en compte l’augmentation des coûts de production des agriculteurs américains, constate Élisabeth Lacoste. La nouvelle politique commerciale américaine vient encore plus protéger la production domestique des fluctuations des marchés mondiaux (au 1er octobre 2025 le sucre brut sur le marché domestique US s’élevait à 35,45 cents la livre, contre 16,15 cents la livre sur le marché mondial, plus du double). C’est une divergence de plus par rapport à la politique de l’UE. »
En Europe, la CGB ne cesse de pointer du doigt le fait qu’il n’existe pas, à proprement parler, de filets de sécurité pour le sucre. Elle demande depuis longtemps une actualisation du seuil de référence du sucre, fixé à 404,40 €/t depuis 2006. Bien que ce seuil ne soit pas juridiquement contraignant pour la Commission – d’ailleurs le prix du sucre est passé au-dessous pendant 45 mois après la fin des quotas – il lui permet de juger la notion de crise que peut traverser la filière. Or, une simple application de l’inflation donnerait un nouveau prix de référence du sucre de 585 €/t. « Il n’y a pour l’instant aucune proposition de la Commission sur la table pour le relever, malgré les demandes des betteraviers et des parlementaires européens », constate Élisabeth Lacoste. En effet, les députés de la Commission agricole du Parlement européen ont demandé, cet été, à ce que ce seuil soit révisé, et à ce que le sucre, puisse, lui aussi, bénéficier de l’intervention publique en cas de crise. Pour Timothé Masson, en charge de l’économie à la CGB, « c’est déjà un premier pas, qui montre que nos arguments sont entendus. Il faudra maintenant s’assurer que cela reste, lors des trilogues de 2026. »
Pour le blé aussi, l’AGPB réclame une revalorisation du prix d’intervention au niveau européen, fixé à 101 €/t depuis 2001 et jamais révisé depuis.
D’un côté de l’Atlantique, la rigidité. De l’autre, la souplesse. Nous sommes dans deux mondes bien différents !
Le One Big Beautiful Bill Act est clairement positif pour les agriculteurs américains. Cependant, la guerre commerciale prolongée avec la Chine représente une menace importante pour les producteurs de soja qui ne peuvent plus exporter vers ce pays. Ne pouvant pas se permettre de mécontenter les agriculteurs, Donald Trump a affirmé, le 25 septembre dernier, qu’il était prêt en compensation à leur reverser une partie des recettes des nouveaux droits de douane. La ministre de l’Agriculture Brooke Collins y travaille.
LES PREMIÈRES ANNONCES DE LA PAC 2028-2034
La Commission a esquissé, cet été, l’architecture de la prochaine PAC, qui combine une réduction du budget, des contraintes environnementales accrues, une forte renationalisation et une dégressivité des paiements directs.
Réduction budgétaire de 17,6 %
La politique agricole commune est intégrée dans un fonds unique où l’agriculture bénéficierait d’une enveloppe protégée de 300 milliards d’euros, soit une baisse de 17,6 %. « Il manque environ 90 milliards d’euros pour financer toutes les mesures actuelles », calcule Yves Madre, président du think tank Farm Europe.
La Commission affirme que cette nouvelle programmation va dans le sens d’une simplification grâce à la flexibilité accordée aux états membres. « En réalité, il s’agit d’une nouvelle étape vers la renationalisation. C’est un appel du pied aux pays qui voudraient mettre de l’argent national quand les autres ne le pourront pas, poursuit Yves Madre. Cette nouvelle PAC va beaucoup dépendre des cofinancements nationaux.
Or, ils sont rarement disponibles, sauf aux Pays-Bas, qui ont montré entre 2021 et 2024 leur capacité à doubler les aides PAC chez eux par des aides d’état nationales. »
Et puis, le président de Farm Europe pointe un risque politique : « la PAC devient un simple programme de mise en œuvre des décisions des ministres des Finances. Il n’y aura quasi plus rien à négocier pour les ministres de l’Agriculture, ni pour la Comagri au Parlement. »
Dégressivité et plafonnement des aides
Le paiement à l’hectare (l’équivalent du DPB) sera plafonné à 100 000 € et sera dégressif (-25 %) dès que le montant sera supérieur à 20 000 €. Entre 50 000 et 75 000 €, il sera réduit de 50 %, et de 75 % au-delà. « La dégressivité commence à toucher les agriculteurs en France à partir de 150 hectares, soit le cœur des agriculteurs de demain. Ils devront consolider leur exploitation et la Commission leur met des boulets aux pieds », déclare Yves Madre. Pour le think tank, cette proposition « semble plus dictée par un souci d’économie que par une vision d’avenir du secteur. »
Politique de gestion des risques
La mise en place d’une réserve de crise de 6,3 milliards d’euros pour la période est un point positif de la proposition de réforme. Il reste cependant « tout à écrire de son fonctionnement pour qu’elle soit efficace et non plus une distribution d’enveloppes pour faire baisser la tension sans résoudre les problèmes financiers », selon Farm Europe.
Nouvelles exigences environnementales
La simplification de la conditionnalité des aides agit en trompe l’oeil. Avec la fin des Bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), on assiste à la renationalisation des mesures agro-environnementales. La conditionnalité sera définie au niveau de chaque pays qui auront obligation d’agir ! Les états membres devront cofinancer les actions agro-environnementales et climatiques au minimum à 30 %, mais ils pourront aller beaucoup plus loin. « 43 % du budget PAC doit être affecté à des mesures environnementales, constate Yves Madre. L’esprit du Green Deal est toujours là. Pour information, les investissements de digitalisation de l’agriculture comptent pour zéro en composante environnementale. C’est interloquant et c’est un exemple parmi d’autres. »
Du côté de la CGB, le dossier est traité, notamment avec les autres associations spécialisées de la FNSEA en charge des grandes cultures. Pour Timothé Masson, en charge de ce dossier à la CGB : « tout n’est peut-être pas à jeter dans la proposition de la Commission européenne. On note, par exemple, un souhait de simplification qu’il faut souligner et qu’il va falloir accompagner. Mais, au-delà du problème de budget, c’est le risque de nationalisation qui fait très peur, car c’est la porte ouverte à de fortes distorsions de concurrence. Notre enjeu, c’est aussi de rappeler que la PAC, c’est également la gestion des marchés. Notre marché est de plus en plus ouvert, de plus en plus concurrentiel : il faut donc, plus que jamais, des outils en cas de prix qui décrochent. Bien construits, cela ne coûte pas cher au contribuable, et ce sont bien avec des prix rémunérateurs et stables que les filières agricoles gagnent en durabilité. »
Pourra-t-on redresser la situation ? Après la proposition de la Commission, le Conseil de l’Union européenne (les états membres) et le Parlement européen doivent se prononcer avant de trouver un accord définitif d’ici à 2027. Les négociations risquent d’être longues et difficiles.
Pour leur premier débat officiel sur les propositions de la Commission européenne, le 22 septembre à Bruxelles, les ministres de l’Agriculture de l’UE se sont montrés très critiques. Leurs principales attaques portent sur la baisse du budget, la disparition du second pilier, le risque de renationalisation ou encore l’éparpillement des dispositions de la PAC dans différents règlements.
Les eurodéputés de la commission de l’Agriculture (Comagri) ont eux aussi dénoncé les coupes budgétaires, la fusion des programmes dans un fonds unique et le risque de renationalisation, lors d’un échange le 24 septembre à Bruxelles avec le commissaire européen, Christophe Hansen.