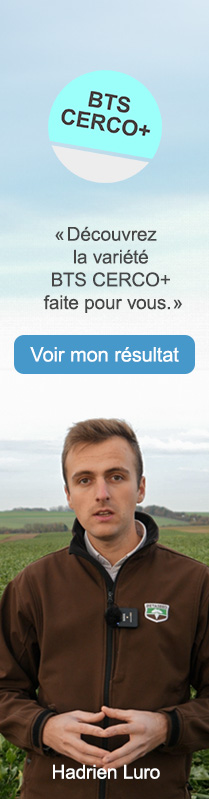Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme à caractère juridique utilisé comme un outil par les collectivités afin de maintenir une cohérence sur le territoire. Chaque PLU comprend différentes zones urbaines (U), à urbaniser (AU), naturelle et forestière (N) et agricole (A).
La zone agricole, (A) d’un PLU, est soumise à une réglementation très encadrée en matière de construction. L’objectif de cette réglementation est de préserver les espaces dédiés à l’activité agricole et de limiter l’urbanisation diffuse. Toutefois, certaines exceptions permettent, sous conditions, la réalisation de bâtiments ou d’aménagements spécifiques. Il est donc essentiel de bien comprendre les principes de base ainsi que les dérogations envisageables.
En zone A, la règle est claire : toute construction est interdite, sauf si elle est strictement liée à une activité agricole, pastorale ou forestière. Cela signifie que seules les constructions indispensables à l’exploitation agricole peuvent être autorisées. Il s’agit, par exemple, d’un hangar agricole, d’une stabulation ou d’une bergerie, d’un bâtiment de stockage de matériel ou de récolte, ou encore d’une serre de production.
Ces projets doivent être portés par un exploitant agricole en activité, avec un projet justifié au regard des besoins réels de l’exploitation.
Bien que le cadre soit strict, plusieurs exceptions réglementaires permettent l’implantation de bâtiments non exclusivement agricoles sous conditions précises. Ces possibilités sont encadrées par l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, ainsi que par des jurisprudences récentes.
Les principales exceptions sont les suivantes :
1 – Agrotourisme : des constructions peuvent être autorisées si elles s’inscrivent dans une activité complémentaire à l’exploitation, comme l’accueil touristique à la ferme (gîtes, chambres d’hôtes, hébergements insolites). Il faut démontrer que cette activité s’intègre dans le fonctionnement global de l’exploitation et contribue à sa viabilité économique.
2 – Transformation et vente des produits agricoles : un bâtiment peut être autorisé s’il est destiné à la transformation ou au conditionnement des produits issus de l’exploitation, ou à leur vente directe (boutique à la ferme). Là encore, une cohérence doit être démontrée entre la surface construite, la production et les débouchés.
3 – Énergies renouvelables : la construction d’installations de production d’énergie (type méthaniseur, panneaux photovoltaïques sur hangar, etc.) est possible si elle est liée à l’activité agricole. Les projets doivent être à échelle cohérente, avec des justificatifs économiques et techniques, et ne pas remettre en cause la vocation agricole du terrain ou du bâtiment.
4 – Logement de l’exploitant : sous conditions strictes, un logement peut être autorisé s’il est indispensable à la surveillance de l’exploitation. C’est le cas, notamment des éleveurs qui doivent rester à proximité des animaux. Cette exception est très encadrée et nécessite un dossier solide démontrant l’impossibilité de logement à proximité dans une zone constructible.
Étude de cas
Céréalier, Pierre demeure sur le siège de l’exploitation familiale. Cette dernière est située en zone agricole A sur le plan local d’urbanisme de sa commune.
L’agriculteur s’associe avec Paul pour se lancer dans la plantation de pommes de terre. Ils projettent la construction d’un nouveau bâtiment pour stocker les tubercules. Sur le toit, les exploitants installeront une centrale photovoltaïque.
Leur construction devrait être autorisée, car ce futur bâtiment s’inscrit dans la continuité de l’activité agricole des deux planteurs. De même, les deux agriculteurs pourraient être amenés à bâtir un laboratoire et un local pour transformer une partie des tubercules en frites fraîches ou en chips.
Toutefois, Paul ne pourra pas édifier sa maison d’habitation sur le siège de l’exploitation de Pierre, car son activité de planteur ne justifie pas une présence permanente.
« Le conseil d’état a été amené à autoriser la construction d’un logement d’habitation en zone A, du fait de la vigilance et de la surveillance permanente exigée par certaines cultures (safran, truffes…) », rapporte Patrice Villerot.