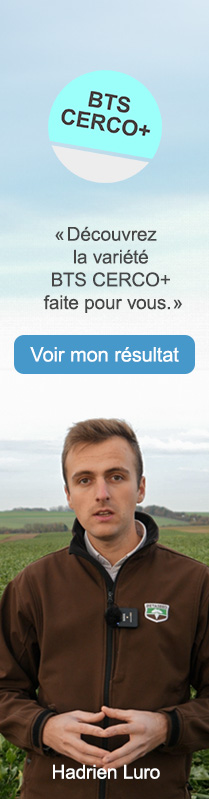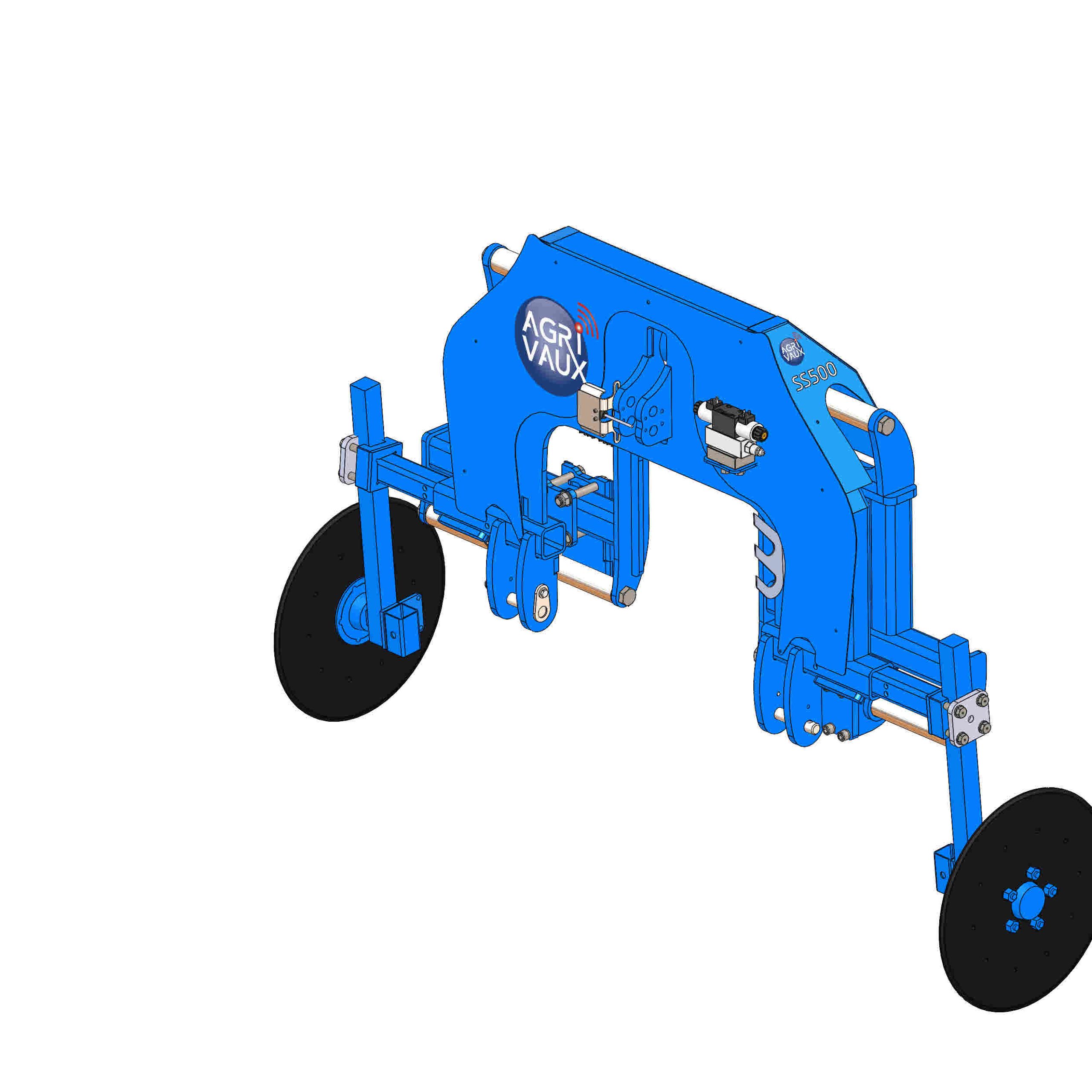« Nous avons eu une super implantation et une période de semis rêvée, mais malgré tous les soins apportés, nous avons des écarts type énormes, parfois au sein d’une même exploitation », constate Benoît Yot, le directeur de la CGB Champagne-Bourgogne. Malgré de bonnes surprises autour des 90-100 t/ha, le bilan s’annonce décevant dans la région. Dans certaines régions, particulièrement touchées par la jaunisse, les chiffres font le grand écart, avec des rendements allant du simple au triple. C’est le cas notamment en Île-de-France, l’Yonne, une partie des Hauts-de-France ou la Champagne, où les rendements oscillent entre 35 et 110 t/ha. « Les écarts-types entre les meilleurs et les moins bons résultats seront relativement importants », résume Emmanuel Pigeon, le directeur de la CGB Hauts-de-France.
Des rendements qui voient jaune
Si, dans les champs, la situation suscite de nombreuses interrogations, un premier facteur explicatif est mis en avant. « Nous avons l’impression que les parcelles qui ont eu le plus de difficulté à lever sont celles qui ont été le plus attaquées par la jaunisse, explique Milène Grapperon, la directrice de la CGB Île-de-France et Centre-Val de Loire. Ces betteraves étaient tout juste au stade couverture du sol quand elles ont fait face à une invasion des pucerons verts et noirs fin mai-début juin. Les symptômes de jaunisse sont apparus vers le 10 juillet ». Les levées tardives se seraient donc montrées particulièrement sensibles au virus. Dans l’Aisne, le phénomène concernerait 15 à 20 % des surfaces, en raison du manque de pluie après les semis.
Dans la Somme et l’Oise, même son de cloche : des doubles levés centrées sur les sols les plus argileux, plus sensibles à la jaunisse devraient amoindrir les rendements. « Ces parcelles ont bénéficié d’une moindre protection pendant la période à risque, où un mauvais contrôle des pucerons a été réalisé », pointe Yohan Debeauvais, le responsable régional de l’ITB.
En Champagne, les zones affectées par des difficultés de croissance printanière ont également été particulièrement touchées par la jaunisse, constatée sur près de 15 % des surfaces selon l’ITB. Une baisse de productivité de 30 % est attendue en moyenne, soit un impact de 3 à 4 tonnes par hectare au moins, au niveau des résultats de la région. « Nous observons une prévalence virale dominante de la jaunisse grave, ce qui corrobore notre hypothèse de contaminations plutôt tardives », explique Maxime Allart, responsable régional ITB Champagne. En Centre-Val De Loire, « les parcelles touchées par la jaunisse, qui ont parfois subi des décalages de semis ou la sécheresse au printemps, pourraient perdre entre 15 et 30 % du rendement », prévient Pierre Houdmon, responsable régional Centre-Val de Loire / Île-de-France / Yonne à l’ITB.
Enfin, le déficit hydrique devrait avoir des effets plus ou moins marqués selon les régions et les types de sols. En témoigne la situation en Centre-Val de Loire ou dans le sud de l’Île-de-France, où les meilleurs rendements se retrouvent dans les zones irriguées. « Des disparités de rendement pourraient être liées au stress hydrique subi par les zones les plus séchantes, aux sols moins profonds », abonde François Courtaux, responsable régional Aisne de l’ITB.
La betterave a fait son sucre
La campagne avait pourtant bien démarré, avec des semis précoces, plutôt prometteurs en matière de rendements. « En Champagne, ce sont les dates de semis les plus précoces que nous ayons connues depuis dix ans », note d’ailleurs Maxime Allart (ITB Champagne). Les premiers chiffres avancés font ainsi état d’une moyenne nationale autour de 83,5 t/ha à 16 °S pour les betteraves déjà réceptionnées (voir graphique). « Les potentiels de rendements sont bons, mais nous observons un gradient Nord/Sud, indique Emmanuel Pigeon (CGB Hauts-de-France). En Normandie, les rendements sont ainsi en hausse de 15 t/ha par rapport à l’année dernière. « C’est positif pour notre compétitivité sur le plan agronomique », réagit Benoît Carton, le directeur de la CGB Normandie. La situation est cependant plus homogène, et positive, en ce qui concerne le taux de sucre des betteraves. « Nous sortons de deux années humides peu propices à la richesse, rappelle Yohan Debeauvais (ITB Somme / Oise). Cette année, les conditions ont été plutôt sèches, avec notamment un déficit en eau de mars à mai, une pluviométrie excédentaire en juin-juillet et un bel ensoleillement en août, propice à l’emmagasinement de la richesse. » L’estimation nationale, au 12 octobre, s’établirait ainsi à 18,3°S, soit presque deux points de plus qu’en 2023 et 2024, selon la CGB (voir graphe). Seule l’Alsace semble, pour l’heure, échapper à cette tendance. « Les rendements sont là, mais nous manquons un peu de richesse, qui ne dépasse pas les 16°S, souligne Yohann Lecoustey, le directeur de la CGB Alsace. La pluviométrie de fin d’été (250 mm cumulés en août et septembre) pourrait être un élément explicatif. Depuis début octobre, le temps ensoleillé fait néanmoins remonter très doucement le taux de sucre. » Contrairement à la situation allemande, le syndrome des basses richesses (SBR) n’est pas la piste privilégiée pour expliquer cette faible richesse. « Nous n’observons pas les signes phénotypiques caractéristiques de cette maladie », précise Yohann Lecoustey.
Une augmentation des parcelles sales
L’impact des maladies du feuillage est, pour leur part, limité. La cercosporiose a été plutôt bien maîtrisée cette année, avec parfois 3 à 4 traitements, et des conditions moins favorables à son développement avec une faible humidité en août et en septembre. « La cercosporiose est très peu présente, contrairement aux quatre dernières années. La richesse en sucre et le poids racine continuent donc de progresser ; c’est une grande satisfaction de retrouver une croissance durant l’automne », se félicite Pierre Houdmon, (ITB Centre-Val de Loire / Île-de-France / Yonne).
D’autres maladies ont pu être observées de manière ponctuelle, comme le mildiou en Normandie. De premiers échos feraient état d’une pression plus importante du rhizoctone durant cette campagne.
Des difficultés sont cependant à souligner en matière de désherbage. « La campagne de désherbage a été parfois compliquée, indique Maxime Allart, (ITB Champagne). Nous avons observé une moindre efficacité des herbicides racinaires, liée au manque d’humidité, et en conséquence une augmentation des parcelles sales, qui représentent environ 15 % des surfaces sur notre région. Le rendement sera forcément dégradé dans ces situations avec des répercussions potentielles sur les rotations à venir. » Le constat est le même plus au Nord, pour son collègue responsable des régions Somme-Oise, où les parcelles sales ont augmenté de 10 %. « Nous sortons de deux années plutôt humides, favorables au désherbage. Le temps sec de cette année y était moins propice », résume Yohan Debeauvais.
De bonnes conditions d’arrachage
Sept semaines après la mise en route des premières usines, la campagne est encore loin d’être terminée. C’est notamment le cas en Normandie. « Les campagnes vont être longues, avec une fin prévue au 15-20 janvier à Etrépagny et à la deuxième semaine de février en Seine-Maritime, où l’usine de Fontaine-le-Dun a ouvert en premier », rappelle Benoît Carton (CGB Normandie). Des précipitations raisonnables et un bel ensoleillement ont assuré des conditions favorables aux premières semaines de la campagne d’arrachage des betteraves. Dans l’Aisne, la Somme et l’Oise, le retour des pluies fin septembre a mis fin à des conditions sèches depuis début août. « Les arrachages se font dans des conditions optimales, résume le directeur de la CGB Normandie, qui appelle à éviter le sur-décolletage au champ, « pour préserver une bonne conservation en silos ».
La tare terre est estimée, au niveau national, à 6,35 %, soit presque deux fois moins que l’année dernière, où la tare terre était de l’ordre de 10 à 12 %. Une moyenne très correcte symptomatique de bons arrachages. « Les conditions d’arrachage sont très bonnes mais le manque d’eau en seconde partie de l’été et la présence de jaunisse aura un impact sur le rendement final dans certaines exploitations. À l’inverse, les résultats sont très bons dans les secteurs ayant bénéficié d’une pluviométrie plus importante et souvent d’une pression jaunisse plus faible », résume Emmanuel Pigeon (CGB Hauts-de-France). En Champagne, où les résultats moyens sont moins bons qu’anticipés, on espère encore « sauver les meubles », à la suite des pluies de début octobre, tout en restant vigilant sur la valorisation à venir des betteraves. « L’équation rendement, charges et prix sera loin d’être équilibrée chez une part importante de nos planteurs en 2025 », souligne Benoît Yot, le directeur de la CGB Champagne-Bourgogne. Pour sa part, François Courtaux (ITB Aisne) se veut positif et se réjouit d’avoir renoué en moyenne, en 2025, dans son département, « avec une performance technique intéressante, qui contraste avec les cinq dernières années. Techniquement, la betterave a encore du potentiel. »
Installé depuis 5 ans dans la Marne, Alexis Leherle cultive 43 hectares de betteraves sur deux sites séparés par 35 km. Celui d’Angluzelles-et-Courcelles a été beaucoup moins touché que les parcelles situées à Clamanges, à 25 km de Châlons-en-Champagne. « En matière de richesse, ce n’est pas si mal mais pour les rendements, il va me manquer 15 à 20 t/ha par rapport au potentiel des parcelles. Je ne comprends pas bien d’où cela vient », explique le betteravier. Malgré des semis réalisés en parallèle, les betteraves ont poussé plus tard à Clamanges, en raison d’un sol moins chaud. « Les parcelles n’ont pas toutes le même potentiel, mais les disparités se sont accrues cette année. On joue un peu au loto tous les ans. De nombreux producteurs se posent des questions. Pour ma part, je souhaite continuer, la betterave est une culture intéressante techniquement, sur laquelle les semenciers sont mobilisés. Nous avons de plus en plus de freins à la production, mais je continue de croire en la betterave. »