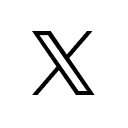Le groupe Avril fait face à des difficultés depuis deux ans. Comment se passe l’année 2018 ?
Le coeur de notre organisation, Saipol, qui triture et estérifie le colza et le tournesol, subit depuis deux ans les affres des importations à bas coûts du biodiesel issu de soja d’Argentine et de palme d’Indonésie. Si nous avions été un groupe standard, nous aurions été contraints de prendre depuis longtemps des décisions drastiques de restructuration. Ce qui nous singularise est d’être un groupe à capitaux agricoles, au service de l’agriculture française. Nous avons la capacité de faire appel à nos capitaux propres pour passer cette mauvaise passe et de nous projeter à moyenlong terme pour trouver des solutions pérennes et garder des usines à côté des zones de production agricoles.
Que mettez-vous en oeuvre pour améliorer la situation ?
Nous avons lancé un important chantier, avec trois volets : améliorer la performance opérationnelle des outils, mieux répartir la valeur ajoutée dans la filière et renforcer le lien entre Avril et les agriculteurs. Si nous ne faisons pas cette transformation, nous allons être exposés à terme à un grave danger. Soit nous sommes en mesure de retrouver de la compétitivité, soit nous serons contraints de prendre des décisions difficiles. Nous attendons par ailleurs des signaux forts de Bruxelles, dans le cadre de la directive RedII, quant à la place des biocarburants de première génération. Des procédures sont engagées devant la Commission européenne contre les importations d’Argentine et d’Indonésie. Mais cela prend du temps. En France, nous avons obtenu l’exemption partielle de la TICPE sur notre carburant B100 à destination des flottes d’entreprises et de collectivités. Nous devrions faire des annonces à l’automne sur le sujet.
Vos autres activités peuvent-elles compenser les pertes de Saipol ?
L’avenir du groupe Avril se porte notamment sur le marché des protéines. Il y a une demande forte pour répondre à la montée en gamme des filières alimentaires souhaitée par la société. Le soja non-OGM connaît un fort développement. À l’heure où l’Europe doit présenter son plan protéines le 23 novembre, l’enjeu est de faire reconnaître la filière soja française et sa qualité. Nous lançons la charte Soja France. Nos activités à l’international, en particulier Lesieur Cristal, connaissent de très bons résultats, au Maghreb et en Afrique. Dans l’oléochimie, notre filiale Oleon est aussi une belle réussite. L’enjeu est de revenir à l’équilibre financier le plus rapidement possible.
La future PAC qui se dessine prévoit moins de budget et davantage de marges de manoeuvre pour les Etats. Qu’en pensez-vous ?
Nous tenons à garder un premier pilier fort. Nous souhaitons que la PAC continue à être une politique économique et non un outil technique dénué de toute vision stratégique. Nous sommes soucieux de conserver des outils de compétitivité pour les filières, à la fois sur la gestion des exploitations et sur la recherche et l’innovation. Un plan d’investissement pour financer des infrastructures pour les grandes cultures aurait également du sens. Un dispositif assurantiel, avec un volet crises et gestion aléas, est à mettre en oeuvre. Aujourd’hui il existe en partie mais ne fonctionne pas suffisamment. Nous sommes prêts à étudier un dispositif sectoriel, à condition que les agriculteurs s’engagent dans l’assurance « Si nous ne voulons pas dépendre demain des importations, il est urgent de retrouver du bon sens collectif » individuelle contre les aléas climatiques. Le collectif n’a de sens que si on est couvert individuellement.
La France multiplie les interdictions de produits phytosanitaires (glyphosate, néonicotinoïdes…), au-delà du cadre européen. Quelles sont les conséquences pour notre agriculture ?
Les agriculteurs ne sont pas les représentants commerciaux de groupes industriels. Il faut arrêter l’hystérie collective. Ils sont des praticiens de terrain qui cherchent des solutions à des problèmes du vivant. Ceux qui pensent que la fin de l’utilisation des produits phytosanitaires est une solution durable sont dans l’erreur. L’idée qui consiste à faire croire que l’on pourrait s’en passer est irresponsable, à la fois économiquement pour nos producteurs, mais aussi en termes de santé publique et de compétitivité pour nos filières. Il faut retrouver de l’équilibre pour expliquer que dans certains cas il est plus judicieux d’utiliser des produits phytosanitaires, que de voir des filières entières disparaître, au profit de produits importés ne respectant ni nos normes ni nos qualités.
Ce message a du mal à être compris par l’opinion publique…
Ce n’est pas parce que cela est compliqué qu’il faut renoncer. Il faut continuer à expliquer et répéter. Si on ne veut pas dépendre demain d’importations chinoises, russes ou américaines pour notre alimentation, il est urgent de retrouver du bon sens collectif. Le seul avis de l’opinion publique ne peut suffire à faire une politique et il est essentiel que le gouvernement prenne en compte la réalité que vivent les acteurs de terrain. Par exemple, le datura, l’ambroisie et l’ergot sont des menaces majeures pour nos cultures.
Vous cultivez 50 hectares de betteraves sur votre ferme de Trocy-en-Multien (Seine-et-Marne). Quel regard portez-vous sur la libéralisation du secteur betterave-sucre ?
Nos entreprises sucrières sont chahutées. Nous avons besoin d’industriels forts. Il faut que les leaders français se rapprochent pour mener le combat de la mondialisation. Il y a trop de querelles de personnes qui paralysent le développement des entreprises sucrières et qui détruisent de la valeur. Les concurrents sont des groupes mondiaux et il y a aussi l’isoglucose à l’international. Vu les enjeux, nous devons travailler ensemble.
Propos recueillis par Adrien Cahuzac