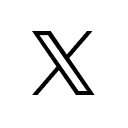Le coût de revient permet de se situer vis-à-vis d’autres exploitations comparables. Cette analyse indique si l’on est dans la moyenne ou plutôt dans les extrêmes. Si son coût est plus élevé, il est important d’en déterminer les causes.
Un indicateur à construire
Le coût de production, ou coût réel, correspond à l’ensemble des charges réelles à payer. Ce sont donc les charges proportionnelles, tels que les intrants (engrais, semences, produits phytosanitaires), et les charges de structure réelles. Ces dernières sont composées des frais de mécanisation (carburants, entretien, travaux par tiers…, ainsi que les amortissements), de la main-d’œuvre (salaires et charges salariales, charges sociales familiales), du foncier (fermages réellement payés et charges foncières), ainsi que des autres charges fixes (construction installation, frais généraux et frais financiers).
Pour obtenir le coût de revient, ou coût complet, il faut partir de ce coût de production et y ajouter le travail de l’exploitant et de sa famille, la rémunération du capital immobilisé dans l’exploitation, ainsi que les fermages calculés sur le foncier en propriété de l’exploitant. Établi à l’unité produite (par exemple, la tonne), il dépend donc de la productivité de la culture.
Pour obtenir un coût de revient par culture, il faut affecter les charges à chaque production. Les intrants sont répartis selon les consommations réelles. Les charges de structure des exploitations non diversifiées sont ventilées par hectare de SAU, alors que pour les fermes diversifiées, le process est plus complexe. Différentes pratiques existent : selon le temps passé par atelier/culture (pour la main-d’œuvre), la surface, le chiffre d’affaires, la marge ou bien au réel, en fonction des factures… Le matériel spécifique est affecté à la culture spéciale, puis les autres charges sont ventilées selon la clé de répartition choisie.
Fixer les clés de répartition n’est pas toujours aisé. Ce sera, par exemple, le cas en polyculture-élevage, avec la valorisation des effluents qui servent aux cultures. Comment bien tenir compte de cet avantage économique lié à une bonne teneur en matière organique des sols ? À quel prix retenons-nous la valeur de ces apports ? On le voit bien, en fonction de chaque situation, bassin de production ou gestionnaire, le coût de revient peut être différent.
Une base de pilotage
Une fois le coût de revient construit, le chef d’entreprise ne pilote plus son exploitation à vue. En se comparant à des fermes similaires, comme son expert-comptable le lui permet, il peut identifier ses surcoûts éventuels et en analyser les raisons. Il définit ainsi ses marges de progrès, qui se situent le plus souvent sur les intrants, la main-d’œuvre ou les postes de mécanisation (matériel en propre ou en commun, récent ou vieillissant…).
Cet exercice permet également de se positionner sur les marchés agricoles et de préciser le point de départ des ventes de la production. Mais il a ses limites. Si l’objectif est de déterminer un plancher pour commercialiser les céréales mais que les marchés n’atteignent jamais ce seuil, l’absence de ventes peut fortement dégrader la trésorerie de l’exploitation. Le coût de revient ne peut donc être qu’une composante de la décision finale. Par ailleurs, l’arrêt d’une production diversifiée engendre souvent une baisse des besoins en traction et en main-d’œuvre. En conservant les équipements et les salariés, les charges sont affectées aux autres cultures, ce qui engendre une hausse de leur coût de revient.
La corrélation étant très forte, il est souvent nécessaire, pour augmenter le revenu, d’améliorer le coût de revient. Mais ce dernier étant lié aux choix stratégiques de l’exploitant, il est primordial d’avoir une approche globale de l’entreprise pour prendre les bonnes décisions, d’autant qu’au-delà de la rentabilité, il faut appréhender la dimension humaine.